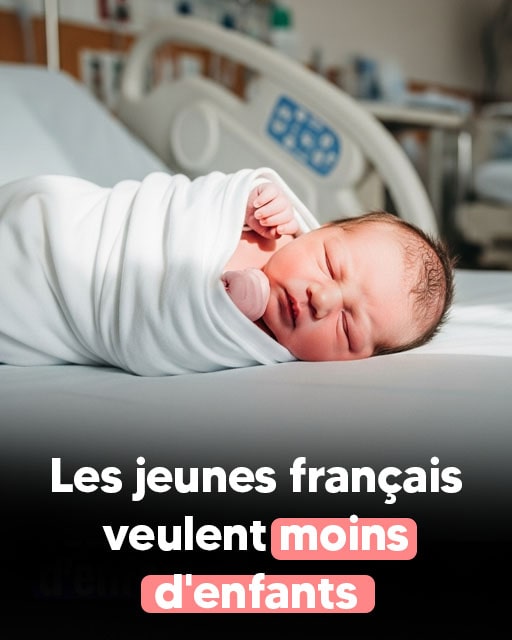Une enquête récente de l’Institut national d’études démographiques (Ined) révèle une baisse marquée chez les jeunes Français dans leur désir d’avoir des enfants, ce qui laisse penser que le nombre d’enfants par femme sera plus faible à l’avenir.
Le nombre idéal d’enfants recule depuis 1998
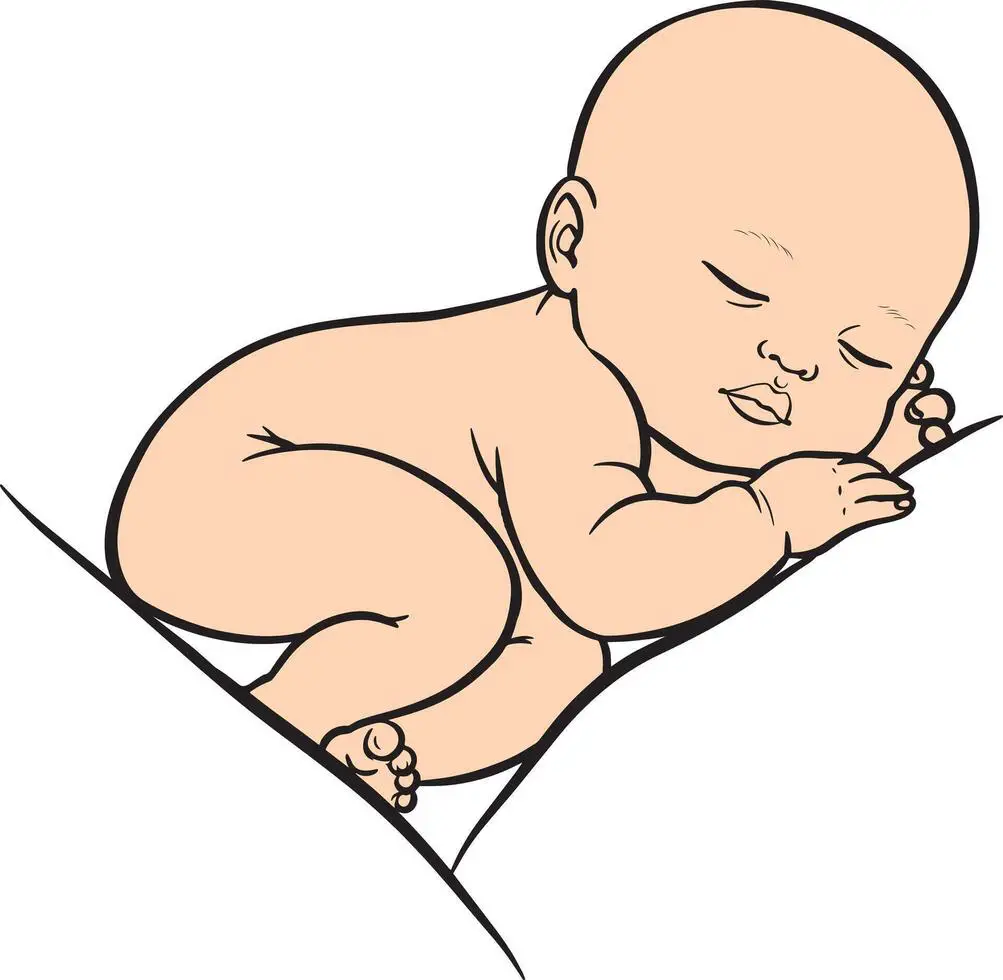
Selon l’Ined, interrogé le 9 juillet, les Françaises estimaient en 1998 que le nombre idéal d’enfants serait 2,7. En 2024, cette moyenne a chuté à 2,3 enfants. Cette enquête s’appuie sur un sondage issu de l’étude Erfi (relations familiales et intergénérationnelles), menée auprès d’un échantillon représentatif de 12 800 hommes et femmes âgés entre 18 et 79 ans .
Ces investigations existent depuis les années 1970, avec la dernière en date avant celle-ci en 2005. Cela permet de mesurer les évolutions des comportements familiaux sur plusieurs décennies . Entre 2014 et 2024, le taux de fécondité est passé de 2 enfants à 1,6 enfant par femme, souligne Laurent Toulemon, chercheur à l’Ined .
Une baisse inédite des intentions chez les jeunes

On observe en 2024 que les jeunes Français ont des intentions de fécondité nettement moins élevées qu’il y a vingt ans : en moyenne 1,9 enfant contre 2,5 auparavant. Ce phénomène est sans précédent dans les données historiques .
Selon la recherche, ces intentions sont traditionnellement légèrement supérieures à la fécondité réelle. Mais les résultats actuels montrent une forte propension à déclarer qu’on envisage zéro ou un enfant chez les jeunes, ce qui rend peu probable une remontée significative de la natalité dans la prochaine décennie .
Évolution spectaculaire des intentions chez les hommes
La nouveauté majeure réside dans le recul expressif des intentions de fécondité chez les hommes. Le souhait d’avoir trois enfants ou plus devient marginal : moins de 10 % pour trois enfants et à peine 5 % pour quatre ou plus, alors qu’en 2005 ces proportions étaient d’environ 25 % et 9 % respectivement. Parallèlement, 15 % des hommes déclarent vouloir zéro enfant (contre 4 % en 2005) et 20 % un seul, contre 8 % à l’époque .
Chez les femmes, 13 % envisagent zéro ou un enfant .
L’égalitarisme masculin associé à une moindre envie d’avoir des enfants
L’enquête souligne que les hommes exprimant des vues égalitaires sur les rôles familiaux montrent en général des intentions de fécondité plus modestes. Ces individus sont souvent prêts à répartir équitablement les responsabilités liées à l’éducation des enfants. Ce lien entre conception égalitaire et désir réduit d’avoir des enfants est ressorti pour la première fois en 2024 .
Pourquoi ce changement ? Freins et aspirations nouvelles
Plusieurs hypothèses expliquent cette transformation :
- Les jeunes perçoivent désormais la parentalité comme une contrainte, et la considèrent comme optionnelle, non obligatoire.
- Dans les générations nées vers 1950, de nombreuses grossesses non planifiées survenaient tôt, alors que les jeunes d’aujourd’hui forment un couple vers 24 ans mais attendent en moyenne jusqu’à 29 ans pour avoir un premier enfant, allongeant ainsi la période de réflexion .
- De nouvelles inquiétudes socio‑écologiques — changement climatique, pression sur les ressources, perspectives pour les générations futures — ainsi que un fort désir de voyage, loisirs et carrière autonome entrent désormais en ligne de compte. Pour beaucoup, la vie adulte peut être pleinement vécue sans enfant, ce qui était moins envisageable autrefois .

En bref
- L’Ined constate une chute importante des intentions de fécondité : le nombre idéal d’enfants est passé de 2,7 (1998) à 2,3 (2024).
- Chez les jeunes, les intentions reculent à 1,9 enfant, contre 2,5 il y a vingt ans — un phénomène sans précédent.
- Les intentions d’avoir zéro ou un enfant augmentent nettement, notamment chez les hommes (15 % et 20 %), alors que les grands désirs familiaux (3 enfants ou plus) déclinent fortement.
- Le tournant vers une conception égalitaire des rôles familiaux, les préoccupations environnementales, et l’aspiration à une vie sans enfants ont transformé les représentations de la parentalité.