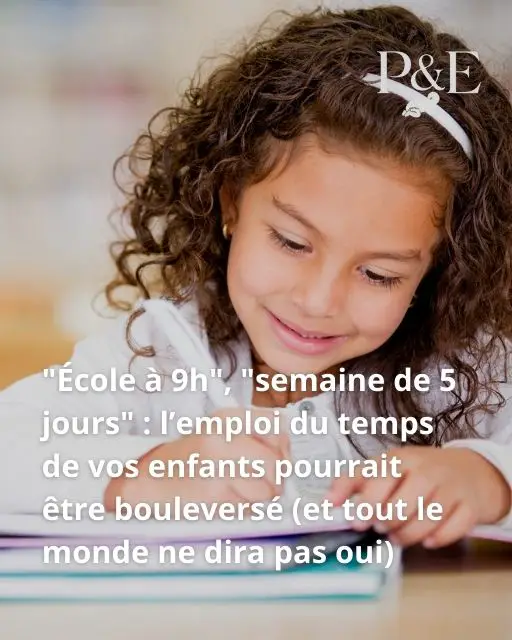Les pistes avancées pour réorganiser l’emploi du temps des élèves suscitent un large débat, car elles pourraient modifier, parfois de manière radicale, leurs journées. Face aux idées évoquées pour repenser les rythmes scolaires et la façon dont s’organise la vie à l’école, de nombreux parents comme enseignants manifestent leurs inquiétudes. Beaucoup redoutent des changements qui pourraient être appliqués rapidement et bouleverser l’équilibre actuel.
La discussion s’est intensifiée à la suite des conclusions rendues publiques par les 130 membres de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant. Leur mission consistait à répondre à une question essentielle : “Comment mieux organiser les différents temps de la vie quotidienne des enfants pour favoriser leur santé, leurs apprentissages et leur développement ?” Leurs propositions, dévoilées le 23 novembre 2025, pourraient transformer en profondeur les journées scolaires si elles sont adoptées par les responsables politiques. Toutefois, elles divisent déjà syndicalistes, experts et acteurs du terrain.
Fruit de six mois d’échanges, de débats et d’analyses, cette liste de recommandations n’a pas fait l’unanimité. Le professeur en sciences de l’éducation Stéphane Bonnery, interrogé par Actu.fr, estime que ce corpus de mesures pourrait réduire le temps d’apprentissage réel et aggraver les écarts entre élèves. Une analyse partagée par le SNUipp, qui considère que revoir les rythmes scolaires ne suffira pas tant que les sources profondes des inégalités ne seront pas réellement traitées. Malgré certaines idées jugées pertinentes, nombreux sont ceux qui craignent que ces propositions nuisent avant tout aux enfants des milieux les moins favorisés.
Un nouveau rythme scolaire qui divise profondément

Parmi les mesures proposées, la Convention avance l’idée d’instaurer une semaine d’école de cinq jours, avec des matinées consacrées aux enseignements fondamentaux et des après-midis réservées à des activités pratiques : ateliers artistiques, sportifs ou culturels. À cela s’ajoutent un début des cours à 9 heures dans le secondaire et un allongement de la pause méridienne à 1 h 30.
Pour Stéphane Bonnery, cette organisation, si elle peut paraître cohérente à première vue, risque surtout d’entraîner une diminution du temps scolaire. Il met en garde contre une vision éclatée des propositions : “On assemble des mesures isolées, mais si l’on observe l’ensemble, on constate une réduction du temps d’école, et donc une augmentation des inégalités.” Selon lui, la priorité devrait être de renforcer le temps d’apprentissage, non de l’amputer.
Le chercheur alerte aussi sur le risque d’accentuer les déterminismes sociaux. Selon lui, les élèves qui s’adaptent le plus facilement aux rythmes scolaires sont souvent issus de milieux intellectuels ou de familles habituées à accompagner les apprentissages. Il explique : “Ces enfants, déjà très sollicités après l’école, ne souffriront pas d’un temps scolaire réduit. Mais qu’en est‑il des autres ?” Il craint que cette réforme ne pénalise davantage les élèves issus de milieux populaires, qui pourraient rencontrer plus de difficultés à obtenir l’orientation souhaitée via Parcoursup si leur temps d’apprentissage est diminué.
Des ajustements horaires qui ne suffisent pas à réduire les inégalités

Parmi les idées défendues, le décalage des horaires scolaires pourrait avoir du sens dans certains contextes, notamment en milieu rural, où les temps de transport sont longs et fatigants, ou encore pour pallier le manque de sommeil chronique chez les adolescents. En effet, de nombreuses études montrent que les collégiens et lycéens manquent de sommeil, ce qui altère leur concentration et leurs performances.
Cependant, pour Stéphane Bonnery, ces réformes restent largement insuffisantes. Il estime que modifier uniquement les horaires ne permettra pas de résoudre les inégalités structurelles. Le SNUipp partage cet avis : “Aucun changement de rythme ne portera ses fruits tant qu’on ne s’attaque pas aux mécanismes qui produisent et renforcent les inégalités.” Le syndicat pointe également les coupes budgétaires récentes dans l’Éducation nationale, qui dégradent déjà les conditions d’enseignement.
Des ateliers l’après-midi qui soulèvent de nombreuses questions
Les propositions qui prévoient de réserver les après-midis aux activités pratiques sont souvent présentées comme un enrichissement pour les enfants. Pourtant, elles soulèvent plusieurs réserves chez les spécialistes. Stéphane Bonnery rappelle que ces activités ne doivent pas être considérées comme secondaires : elles reposent elles aussi sur des apprentissages essentiels qui nécessitent un cadre structuré.
Il s’inquiète également du recours possible à des intervenants extérieurs pour animer ces ateliers, estimant que ces contenus devraient rester sous la responsabilité d’enseignants formés. Dans le même sens, Sophie Vénétitay (SNES-FSU) met en lumière les fortes disparités financières entre collectivités : certaines communes pourront proposer des activités variées et de qualité, tandis que d’autres devront se limiter à des options réduites. Une situation qui pourrait une fois de plus creuser les inégalités territoriales.
Les devoirs à l’école : une avancée possible, mais à encadrer
La proposition consistant à faire les devoirs à l’école fait partie des mesures les mieux accueillies. Elle permettrait en effet d’offrir un temps d’accompagnement structuré aux élèves qui ne bénéficient pas d’un environnement favorable au travail personnel à la maison.
Stéphane Bonnery met toutefois en garde contre un risque majeur : il ne faudrait pas que ce temps empiète sur les heures de cours. “L’objectif n’est pas de rallonger la journée de manière punitive, mais bien de donner à tous les élèves un temps dédié pour apprendre et consolider ce qui a été vu en classe.”
En définitive, si ces propositions visent à améliorer le bien-être et les apprentissages des enfants, elles devront être pensées dans une logique cohérente et globale. Sans cela, elles pourraient non seulement manquer leur objectif, mais aussi aggraver les inégalités scolaires déjà existantes.